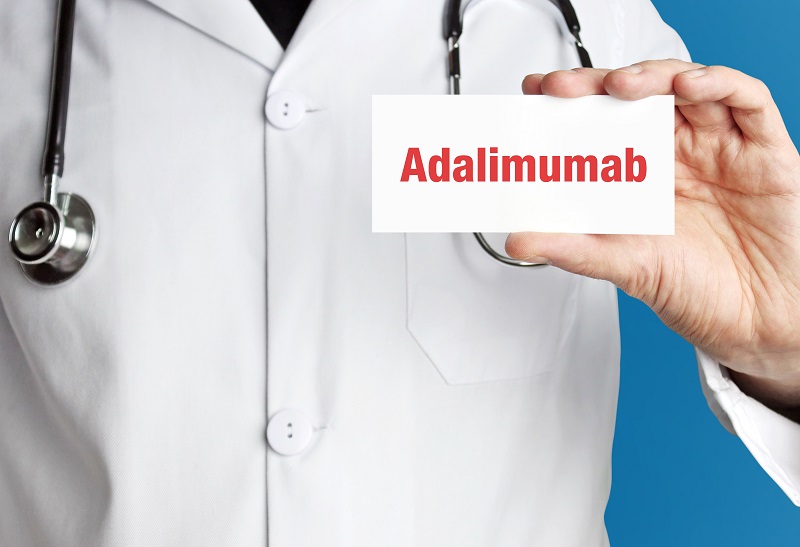L’Algérie vient de franchir une nouvelle étape dans sa politique d’ouverture pharmaceutique en accordant une autorisation d’importation à un médicament biosimilaire chinois, destiné au traitement de plusieurs maladies auto-immunes graves telles que la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn ou encore le psoriasis sévère.
C’est le groupe Sino Biopharmaceutical, via sa filiale Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group (CTTQ), qui a obtenu l’aval de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) pour introduire sur le marché algérien un biosimilaire de l’adalimumab, molécule de référence commercialisée sous le nom de marque Humira. Ce traitement est l’un des médicaments biologiques les plus prescrits et les plus lucratifs au monde.
Qu’est-ce qu’un biosimilaire, et en quoi diffère-t-il d’un générique ?
Si les termes « biosimilaire » et « générique » sont parfois utilisés de façon interchangeable dans le langage courant, ils désignent en réalité deux types très différents de médicaments, tant par leur nature que par leur processus de fabrication et de validation.
Un médicament générique est une copie exacte d’un médicament chimique déjà approuvé, dont le brevet est tombé dans le domaine public. Il contient la même molécule active, dans la même quantité, et se présente sous la même forme pharmaceutique que l’original. Sa production est relativement simple, car les médicaments chimiques sont composés de petites molécules facilement reproductibles.
En revanche, un biosimilaire est une réplique très proche, mais jamais identique, d’un médicament biologique de référence. Les médicaments biologiques, comme l’adalimumab, sont fabriqués à partir de cellules vivantes modifiées génétiquement. Ils sont donc complexes, sensibles à leur environnement de production, et impossibles à reproduire de façon exacte. Un biosimilaire est développé de manière à avoir une efficacité clinique équivalente, une sécurité comparable et une qualité rigoureusement contrôlée, mais il nécessite des études cliniques supplémentaires pour prouver sa similarité avec le produit de référence.
Autrement dit, là où un générique peut être autorisé sur la base d’une simple équivalence chimique et pharmacocinétique, un biosimilaire doit démontrer sa concordance thérapeutique dans des essais spécifiques. D’un point de vue économique, les biosimilaires coûtent plus cher à développer que les génériques, mais restent nettement moins chers que les médicaments biologiques d’origine, ce qui en fait une solution stratégique pour les systèmes de santé.
Un enjeu économique et stratégique pour l’Algérie
L’arrivée de ce biosimilaire chinois sur le marché algérien ne relève pas du simple approvisionnement pharmaceutique. Elle illustre une dynamique plus large : celle de la montée en puissance de la Chine dans le secteur de la santé en Afrique du Nord, et notamment en Algérie, où le système de sécurité sociale garantit la gratuité des soins hospitaliers et le remboursement à 100 % des traitements pour les maladies chroniques.
Ce contexte offre une opportunité commerciale majeure pour des laboratoires comme CTTQ, qui souhaitent étendre leur présence internationale. Le groupe aurait déjà entamé des démarches pour établir des partenariats de distribution en Algérie, selon des sources proches du dossier. En misant sur un médicament à la fois efficace, reconnu et plus abordable que l’original, Sino Biopharmaceutical espère s’imposer comme un acteur de poids sur le marché algérien, voire dans la région.
En toile de fond, cette autorisation pourrait aussi stimuler le débat sur la production locale de biosimilaires et sur la coopération pharmaceutique sino-algérienne, dans un secteur hautement stratégique à la fois pour la santé publique et pour la souveraineté industrielle.
L.R.